Diffusé depuis le 19 mars sur Canal+, Les Disparues (2024) de Sabrina Van Tassel nous entraine au cœur d’une tragédie méconnue : la disparition de milliers de femmes amérindiennes aux États-Unis. À travers le destin bouleversant de Mary Ellen Johnson-Davis, la réalisatrice franco-américaine dénonce l’impunité et l’indifférence qui entourent ces drames.
◆ Mary Ellen Johnson-Davis : une vie brisée dès l’enfance
Le 25 novembre 2020, Mary Ellen Johnson-Davis, 38 ans, disparaît près de Firetrail Road, dans l’État de Washington. Membre de la tribu Tulalip, cette mère de quatre enfants ne reviendra jamais d’un rendez-vous près d’une église, aux abords d’un bois. Son absence devient le point de départ d’une enquête glaçante : celle du silence autour des femmes autochtones disparues. Mais la tragédie de Mary Ellen a commencé bien avant ce jour fatidique. Arrachée à sa famille biologique à l’âge de quatre ans, elle est placée dans une famille d’accueil où elle subit des abus sexuels. De retour dans sa communauté, elle tente de se reconstruire, mais ses blessures sont très profondes. Comme beaucoup d’autres femmes autochtones, elle porte le poids d’une histoire collective de déshumanisation.

◆ Le traumatisme des pensionnats
Derrière le parcours tragique de Mary Ellen se cache une blessure historique partagée par les peuples autochtones : celle des pensionnats pour enfants amérindiens. Du 19e siècle jusqu’aux années 1990, ces écoles, mises en place par les gouvernements américain et canadien, visaient à assimiler de force les jeunes autochtones.
Les enfants y étaient séparés de leurs familles, interdits de parler leur langue, de pratiquer leur culture, souvent maltraités, parfois violés, et pour beaucoup, jamais rendus à leurs proches. Ces institutions, qualifiées aujourd’hui de « génocide culturel » par les commissions officielles, ont généré une rupture profonde dans les liens communautaires et transmis des traumatismes qui perdurent encore aujourd’hui. Ce terreau historique explique en partie la vulnérabilité actuelle des femmes autochtones aux violences et aux disparitions.

◆ Un système judiciaire défaillant
Les Disparues met également en lumière une défaillance juridique dramatique. Dans de nombreuses réserves, les juridictions tribales n’ont pas le droit de poursuivre les auteurs de crimes non-autochtones, même lorsque les victimes en sont membres. Ces limitations laissent des zones entières dans une forme d’impunité quasi totale.
Comme l’explique l’avocat Gabriel Galanda dans le film, les réserves sont devenues des “zones de chasse” pour certains prédateurs, en raison du vide juridique qui y règne. Et les chiffres font froid dans le dos : une femme amérindienne sur trois disparaît ou est assassinée, une sur deux est violée. Dans l’immense majorité des cas, les coupables ne sont jamais poursuivis. En effet, selon une étude de l’Urban Indian Health Institute menée en 2020, plus de 7000 femmes autochtones ont disparu ou ont été tuées aux États-Unis, mais ces tragédies restent largement ignorées par les autorités et les médias. Le chiffre est d’autant plus frappant lorsqu’on sait qu’une femme amérindienne sur trois est susceptible de disparaître ou d’être assassinée au cours de sa vie. Ces femmes sont en grande partie victimes de violences domestiques ou d’enlèvements, souvent dans un silence total des autorités.

◆ Sabrina Van Tassel : le cinéma comme arme de justice
Réalisatrice franco-américaine et journaliste grand reporter, Sabrina Van Tassel se lance dans le documentaire et le reportage en 2004. En quinze ans, elle signe plus d’une quarantaine de reportages d’investigation et de documentaires engagés, où son travail porte un regard sans concession sur le monde d’aujourd’hui et ses problématiques sociales. Parmi ses œuvres marquantes, on trouve Mariées pour le pire (2004), un documentaire sur deux femmes victimes de mariages forcés, Les soldats perdus de Tsahal (2008), qui explore le syndrome de stress post-traumatique dans l’armée israélienne, ou Jeunes filles à vendre (2015), qui se penche sur le trafic sexuel de mineures. Elle a aussi réalisé Femmes dans le couloir de la mort (2018), qui dévoile le sort des femmes condamnées à mort aux États-Unis.
La Cité muette (2015) est son premier long-métrage documentaire, plébiscité par la presse, qui raconte l’histoire du camp de Drancy, où la quasi-totalité des Juifs français furent internés, et qui fut réhabilité en logement social à la fin de la guerre.
En 2021, elle signe L’État du Texas contre Melissa, un film multi-primé qui raconte l’histoire de Melissa Lucio, la première femme hispanique condamnée à mort au Texas. Ce documentaire a eu un impact médiatique majeur, contribuant à sauver la vie de Lucio, qui était à 48 heures de son exécution, après une campagne internationale d’une ampleur exceptionnelle.
Avec Les Disparues, Sabrina poursuit son engagement en dévoilant les violences et les injustices que subissent les femmes autochtones. Sa caméra s’efface devant les témoignages poignants qu’elle recueille avec une grande pudeur et un profond engagement.
En redonnant un visage, une voix et une mémoire à Mary Ellen Johnson-Davis et aux innombrables disparues, Sabrina Van Tassel signe un documentaire aussi nécessaire que bouleversant. Les Disparues n’est pas seulement un cri contre l’indifférence, mais une invitation à regarder l’Histoire en face et à agir pour que ces femmes ne soient plus jamais oubliées. Il est temps que les abus sur les femmes cessent partout dans le monde !
« Ce que vous ignorez peut vous tuer. Ce que nous ignorons les tue, elles »,
Sabrina Van Tassel
Jessica Baucher
Les Disparues est disponible sur myCANAL et a été diffusé sur Canal+ Docs le 19 mars 2025, puis sur Canal+ le 27 mars 2025.
* Pour aller plus loin…
Bande annonce en français
Interview de Sabrina Van Tassel pour ELLE
Photo en tête d’article : Les disparues ©Tahli Films







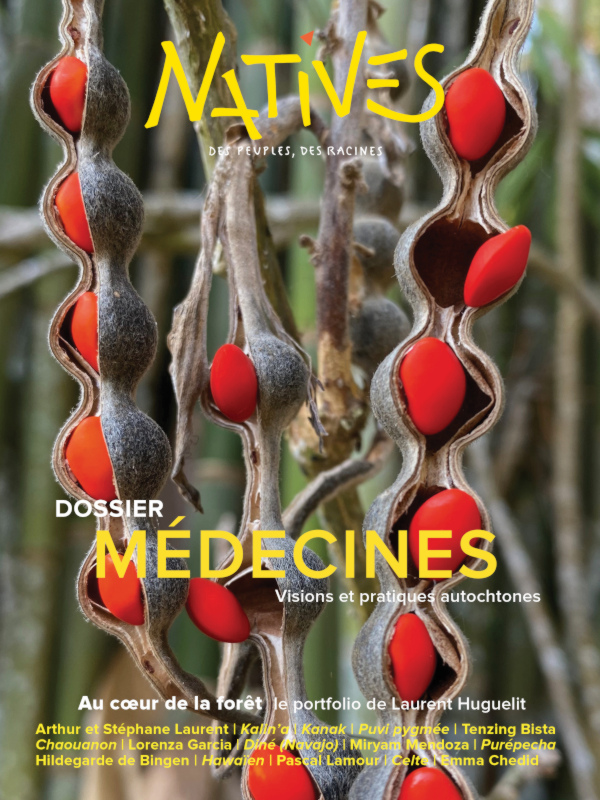
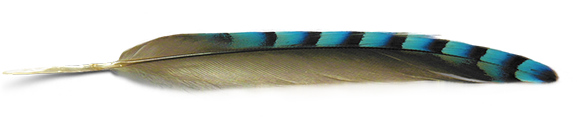



No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.