Jean-Claude Barny, réalisateur engagé et passionné par les luttes anticolonialistes, signe en 2025 son troisième long-métrage, Fanon, un film qui retrace l’histoire de Frantz Fanon, psychiatre et militant pour l’indépendance de l’Algérie. À travers ce biopic, Barny propose une immersion intense dans le parcours intellectuel et militant de Fanon, tout en mettant en lumière la question des identités coloniales et post-coloniales. Le film se distingue non seulement par son traitement de la figure emblématique de Fanon, mais aussi par la manière dont il lie son héritage à l’histoire contemporaine, en s’inscrivant dans une réflexion plus large sur le racisme systémique et les effets de la colonisation. Cependant, malgré la pertinence de son sujet et son importance historique, Fanon semble faire face à une certaine résistance, car plusieurs salles en France refusent de le diffuser…
◆ L’Histoire et la pensée de Frantz Fanon
Frantz Fanon est une figure incontournable de l’histoire des luttes anticoloniales. Né en 1925 à Fort-de-France en Martinique, il grandit dans un contexte colonial marqué par la domination française sur les territoires antillais. Dès son jeune âge, il expérimente le racisme, notamment lorsqu’il rejoint les Forces françaises libres pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est dans ce contexte qu’il prend conscience de la réalité complexe de l’identité coloniale et du racisme structurel. Cet engagement se heurte toutefois à une profonde désillusion vis-à-vis de la société française dans laquelle, à l’époque, les Noirs étaient systématiquement discriminés. Ce sentiment de déshumanisation devient une force dans son parcours intellectuel et politique.
Après la guerre, Fanon poursuit des études de médecine, devenant psychiatre, mais c’est surtout à travers ses écrits qu’il façonne son héritage intellectuel. Son ouvrage majeur, Peau noire, masques blancs (1952), est une réflexion poignante sur l’identité, l’assimilation et le racisme. Il y explore la condition des Noirs dans un monde colonial, en analysant la souffrance psychologique des individus soumis à un racisme systémique. C’est également dans cette période qu’il s’intéresse à la question de la violence comme moyen de libération, une idée qu’il approfondira dans son ouvrage Les Damnés de la Terre (1961), dans lequel il théorise la révolte contre l’oppression coloniale. Fanon n’est pas seulement un intellectuel : il est un acteur du changement, un penseur en action qui se bat pour la décolonisation, non seulement de l’Algérie, mais aussi de la pensée elle-même.
En 1953, Fanon est nommé médecin-chef à l’hôpital psychiatrique de Blida, en Algérie, où il se trouve en première ligne pour observer les conséquences psychologiques du colonialisme. Là, il analyse les traumatismes infligés aux populations colonisées, en particulier les Algériens, pris dans les tourments de la guerre d’indépendance. C’est dans ce contexte qu’il publie un certain nombre d’ouvrages politiques et philosophiques qui articulent sa vision de la décolonisation. Expulsé d’Algérie en 1956 en raison de ses liens avec le FLN (Front de Libération Nationale), il s’exile à Tunis et devient un ardent défenseur de la cause algérienne et de la révolution.

◆ Le film “Fanon” : une immersion dans la guerre d’Algérie et la psychologie coloniale
Fanon de Jean-Claude Barny n’est pas qu’un simple biopic, il s’agit d’une immersion profonde dans la guerre d’Algérie et l’impact de la colonisation sur les individus et les sociétés. Barny, par le biais de son film, réactive la pensée de Fanon, tout en cherchant à mettre en lumière les racines profondes du racisme et d’une certaine forme d’aliénation. Pour comprendre le projet cinématographique de Jean-Claude Barny, il faut d’abord saisir le contexte dans lequel ce film s’est écrit.
Jean-Claude Barny, réalisateur d’origine guadeloupéenne, s’est toujours intéressé aux questions de décolonisation et d’identités culturelles. Dans son travail, il explore souvent les racines de l’aliénation sociale et les luttes identitaires au sein des sociétés post-coloniales. Dans Fanon, il ne cherche pas seulement à raconter l’histoire de Frantz Fanon, mais à faire vivre ses idéaux, ses combats et son héritage. Le film s’intéresse particulièrement à la période de son engagement en Algérie, un moment décisif dans son parcours. Barny choisit de situer l’histoire au cœur de la guerre d’indépendance, une période où Fanon, tout en poursuivant son travail de psychiatre, s’est lancé dans une lutte acharnée pour la libération des peuples colonisés.
Un élément clé du film est la mise en scène de l’hôpital psychiatrique de Blida, où Fanon exerce. À travers cette institution, le film interroge la manière dont la psychiatrie coloniale a contribué à l’oppression des Algériens. L’hôpital, qui dans l’imaginaire collectif pourrait être perçu comme un lieu de soin, devient ici un espace où les traumatismes liés à la colonisation sont exacerbés. Les patients, souvent des résistants ou des civils traumatisés par la guerre, représentent une population aux prises avec les effets dévastateurs du colonialisme. Son héros, le psychiatre Fanon, dans son approche, se trouve face à des dilemmes éthiques et politiques : comment soigner des individus tout en étant conscient de l’injustice systémique qui les détruit ?
Le film explore cette question centrale : est-il possible de soigner sans lutter contre l’origine du mal ? La réponse de Fanon est claire : la lutte pour l’indépendance est indissociable de la guérison des individus. C’est dans ce cadre que Fanon se distingue des autres biopics, en abordant non seulement la vie personnelle de Fanon, mais aussi ses théories, ses combats et son engagement révolutionnaire.

◆ Une oeuvre aboutie
Jean-Claude Barny met également un accent particulier sur la dimension visuelle et sonore de son film. L’univers visuel de Fanon est profondément marqué par une volonté de restitution historique et de mise en scène émotionnelle. Le film, tout en ayant un côté pédagogique, ne se contente pas de reproduire des événements historiques, il cherche à restituer une atmosphère, à faire sentir au spectateur l’intensité de la guerre, des souffrances psychiques et des luttes politiques. Lumière, décors et costumes sont soigneusement choisis pour refléter la réalité de l’époque, tout en conférant au film une dimension symbolique forte.
La bande son, également, est un élément essentiel pour comprendre le film. En s’appuyant sur des influences musicales variées, allant du jazz au funk, le réalisateur crée une atmosphère où la musique devient un vecteur de transmission de l’émotion et des idéaux de Fanon. En particulier, l’album Clameurs de Jacques Coursil, musicien martiniquais, est utilisé pour amplifier les moments forts du film. Cette bande-son devient un moyen d’expression de la résistance, en écho à la musique afro-américaine et à la lutte anticoloniale.

◆ Un film universel
Fanon de Jean-Claude Barny est bien plus qu’un film sur un homme. Il est un témoignage vivant de la résistance face à l’injustice, une réflexion sur les blessures laissées par le colonialisme et un appel à la lutte contre le racisme systémique. Le film ne se contente pas de raconter l’histoire de Frantz, il confronte le spectateur à des problématiques toujours d’actualité. À travers le personnage de Fanon, Barny pose une question centrale : comment se libérer de l’aliénation imposée par les structures coloniales et les héritages du passé ?
Ce film est également une réflexion sur l’engagement politique et sur la manière dont les artistes peuvent contribuer à changer le monde. En rendant hommage à Fanon, Jean-Claude Barny nous invite à réfléchir à notre propre époque, aux défis auxquels nous faisons face en matière de racisme, d’identité et de justice sociale. Fanon est un film nécessaire, un appel à la résistance intellectuelle et militante qui traverse les générations. Il nous rappelle que chaque époque doit trouver sa propre mission, et qu’elle a la responsabilité de la remplir ou de la trahir, comme le disait Frantz Fanon lui-même !
Malgré la profondeur et la pertinence du film, Fanon semble avoir rencontré des résistances dans le milieu cinématographique français. Plusieurs salles de cinéma (dont les MK2) ont choisi de ne pas le diffuser, illustrant une forme de censure tacite qui interroge sur la difficulté de reconnaître et de se libérer du passé colonial français, notamment par rapport à l’Algérie. Ce refus de diffusion, bien qu’il n’entame en rien la puissance du film, soulève des questions sur la manière dont certains films qui abordent des thèmes de décolonisation ou de lutte contre le racisme trouvent encore des obstacles dans leur chemin vers le grand public… Certaines plaies ne cicatrisent jamais complètement.

« Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir », Frantz Fanon, Les Damnés de la Terre
Jessica Baucher
Photo en tête d’article : Fanon ©Eurozoom







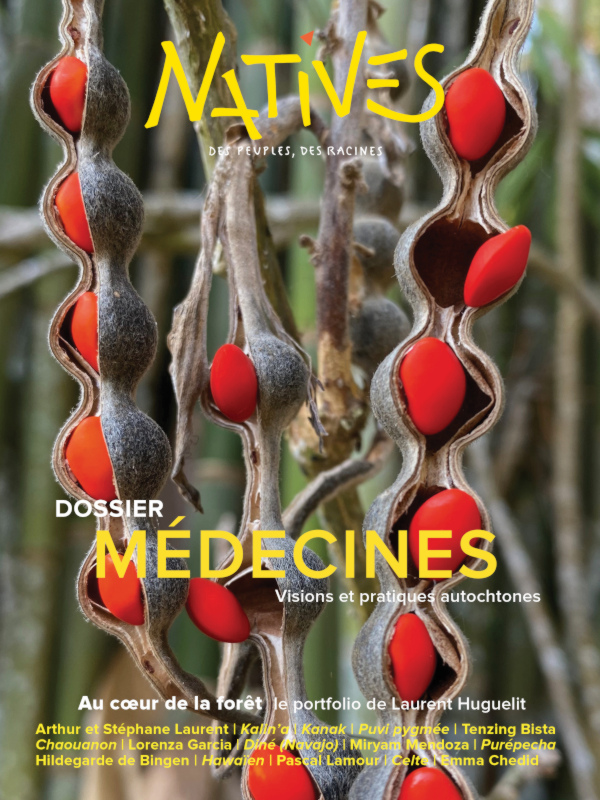
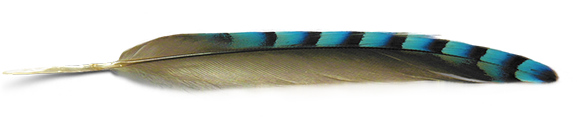



No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.