Dans le cadre de l’Année du Brésil, les Franciscaines de Deauville consacrent une rétrospective monumentale à l’œuvre de Sebastião Salgado, célèbre photographe brésilien. Une sélection de 166 de ses plus belles images prises aux quatre coins du monde, des images en noir et blanc d’une incroyable puissance, profondément humanistes. La Maison Européenne de la Photographie qui, depuis les années 1980, suit et conserve son travail, a sorti ses tirages historiques et assure le commissariat de l’exposition.
Né en 1944 à Aimorés, au Brésil, Sebastião Salgado intègre l’Organisation Internationale du Café après des études en économie. Ses missions le conduisent aux quatre coins du globe, où il découvre la photographie, une passion qui deviendra sa vocation. En 1969, à la suite du coup d’État militaire et au durcissement de la dictature, il fuit le Brésil avec sa femme Lélia Wanick Salgado. Ils trouvent refuge à Paris en 1973, année où il quitte son poste pour se consacrer pleinement à son art. Tout d’abord en collaborant à des agences réputées comme Sygma, Gamma et Magnum, avant de fonder avec son épouse l’agence Amazonas Images. De 1977 à 1984, Salgado parcourt l’Amérique Latine, de la région torride du Nordeste du Brésil, jusqu’aux montagnes du Chili, de la Colombie au Mexique, partageant la vie de communautés isolées pendant de longues semaines. Il en tirera son premier livre, Autres Amériques. Puis il documente la condition des travailleurs immigrés en Europe et les ravages de la sécheresse et de la famine en Afrique (1984 1985), notamment au Sahel, au Soudan et au Tigré.

Il se lance ainsi dans de vastes fresques photographiques. Ce sera La Main de l’homme (1986-1992) où, pendant six ans, il parcourt trente-cinq pays à la recherche des industries en voie de disparition, et qui emploient encore des travailleurs manuels, puis Exodes (1994-1999), où il documente les vastes mouvements migratoires qui bousculent les équilibres de notre planète. Taraudé par les horreurs qu’il a vues, à force de côtoyer la misère et la souffrance au fil de ses nombreux reportages, Salgado traversera une période sombre, faite de doute et de mélancolie. Il dira que le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 lui a donné « honte d’appartenir à l’espèce humaine ». Salgado abandonne alors la photographie et reprend la ferme de sa famille au Brésil avec son épouse Lélia. En 1998, le couple se met à planter des milliers d’arbres (3,4 millions à ce jour, soit le plus grand projet écologiste du pays) pour combattre la déforestation massive de l’Amazonie, reboisant plus de 600 hectares. Un exploit immortalisé par Wim Wenders dans son film documentaire Le Sel de la terre. Cette expérience lui donnera une énergie nouvelle. « Cela m’a donné une envie folle de me remettre à la photographie. C’est ainsi qu’est né Genesis, un projet qui nous a permis de découvrir tout ce qui n’a pas été détruit écologiquement », dit-il.

◆ L’humanité au cœur de son œuvre
La première partie de l’exposition retrace le cheminement d’un auteur engagé qui s’est confronté aux tourments de l’humanité. Ses images mettent en lumière les grandes mutations de notre époque, dont sont victimes les populations les plus fragiles, subissant les conflits et la pauvreté ; ainsi que les dérives tragiques, tant humaines qu’environnementales, de la société industrielle. Le parcours débute avec Autres Amériques (1977-1984), son premier projet personnel, où il saisit l’essence de l’Amérique latine, et montre la persistance des cultures indiennes et paysannes. Il affirme d’emblée son style unique et sa maîtrise du noir et blanc. S’ensuivent de larges extraits de son second projet La Main de l’homme (1986-1992), une sorte d’archéologie visuelle d’une époque que l’Histoire connaît sous le nom de Révolution industrielle. Les photos sont saisissantes de réalisme, bouleversantes et parlent d’elles-mêmes. Les visiteurs sont amenés à se confronter à des images dures qui ont fait la première renommée du photographe. Tout un monde de damnés en proie à la violence du monde. Recherchant une lumière qui tend vers le sacré, l’artiste fait passer des images à visée documentaire au rang d’œuvres d’art, tant l’esthétique est travaillée.

Ainsi l’image particulièrement forte de ce chercheur d’or portant un sac de boue supposée aurifère sur son dos, remontant au péril de sa vie sur une frêle échelle du fond d’une immense mine à ciel ouvert : la Serra Pelada (aujourd’hui fermée), ouverte en 1979 dans l’Etat de Pará, au Brésil. Ou en 1991, celle d’un homme épuisé, couvert de mazout, le visage complètement défait, alors que la guerre du Golfe se termine au Koweït et que des hommes tentent d’éteindre les puits de pétrole en feu. « C’était sublime et terrible. Ils risquaient leur vie. Quand l’eau était déversée, il y avait des explosions de gaz mortelles. Le bruit était si fort, c’était comme travailler dans la turbine d’un jet. J’y ai perdu la moitié de mon audition », raconte Salgado. Exodes, (1994-1999), relate l’abandon des campagnes vers les villes, l’immigration économique, les réfugiés fuyant les conflits et qui achèvent leur voyage le plus souvent dans les bidonvilles surpeuplés. Ce projet raconte le périple des Latino- Américains vers les États-Unis, l’exode vietnamien, les populations afghanes déplacées, le drame des réfugiés de l’ex-Yougoslavie, des réfugiés hutus venus du Rwanda, le mouvement des paysans sans terre au Brésil, et les enfants de l’exode avec une série de portraits émouvants.

◆ Genesis : à la recherche du monde des origines
Le parcours se conclut avec Genesis, projet commencé en 2004, qui célèbre les territoires restés à l’abri de la folie des hommes et qu’il est vital de préserver. De 2004 à 2012, Salgado fera près de trente-deux voyages aux confins du monde, des Galápagos à l’Afrique, des déserts arides aux glaces de l’Arctique, en passant par la luxuriante forêt amazonienne et les tribus qui l’habitent. Cette deuxième partie de l’exposition nous révèle des paysages grandioses, une faune sauvage allant des animaux du delta de l’Okavango au Botswana aux gorilles du parc des Virunga à la frontière du Rwanda, du Congo et de l’Ouganda. Sans oublier les peuples qui ont échappé au monde contemporain : le peuple Himba de Namibie, les tribus Dinkas du Soudan, le peuple San du désert du Kalahari au Botswana, les tribus Omo du sud de l’Éthiopie et les anciennes communautés chrétiennes du nord, ou encore les ethnies de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Admirons ce Papou de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui nous décoche un regard espiègle, vêtu du costume traditionnel du sing-sing – une danse rituelle locale inspirée de celle du grand paradisier bleu, un oiseau magnifique. Ou encore ce mudman (« homme de boue ») de la tribu Asaro portant un masque confectionné avec de la boue argileuse et de longs faux ongles en bambou, semblables à des griffes. Cette immersion dans l’univers artistique et intellectuel de Salgado couvre plus de cinquante ans de carrière. Le bilan d’une œuvre exceptionnelle et aussi d’une vie pleinement remplie.
Brigitte Postel
Sebastião Salgado
Du 1 er mars au 1 er juin 2025
Les Franciscaines
145 b Avenue de la République
14800 Deauville
+ Crédit photo en-tête d’article : ©Les Franciscaines / Sebastião Salgado



 Abonnement 1 an
Abonnement 1 an




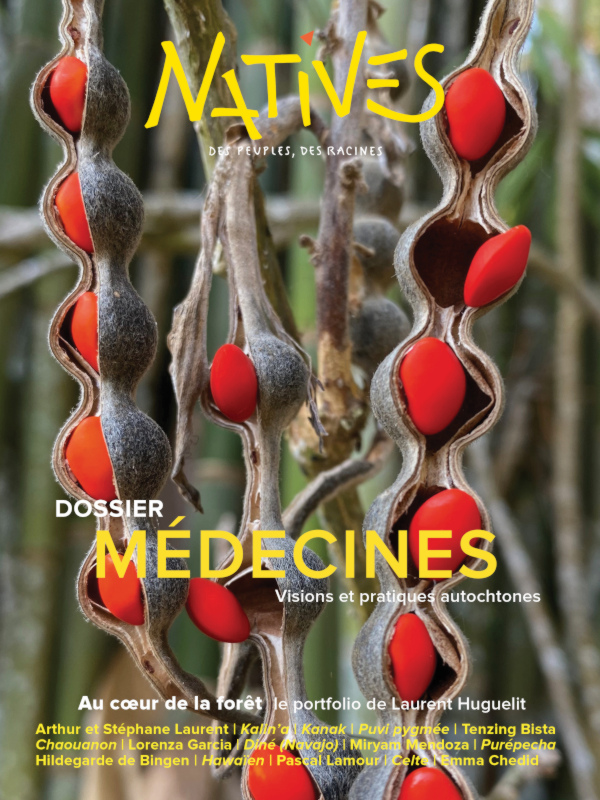
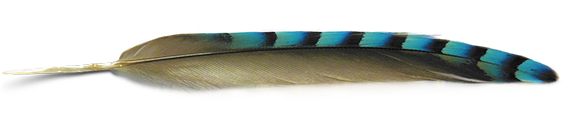


No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.